démarche artistique
Peintures, 1992 à aujourd’hui, parcours
La peinture demeure une matière simple et directe, un art premier, au même titre que la sculpture ou la musique. Elle fait appel au sensible, aux sensations physiques pures. Dans ce sens mon travail s’invite dans le sujet, la matière et le support, elle n’est pas une réflexion ou une mise à distance de ce moyen d’expression. Dans le contexte suisse et français de ces 30 dernières années, il a fallu presque s’excuser d’être peintre. Ni les Anglais, ni les Allemands, ni les Américains n’eurent à le faire. Aujourd’hui on commence à peine à se détendre et à considérer que les peintres sont des artistes comme les autres. Cette longue traversée a été salutaire pour renouveler, libérer la peinture et la mettre sur le même pied que la photographie, la vidéo ou les installations. Bill Viola, Anish Kapoor ou James Turrel sont, à mes yeux, de grands peintres (sans peinture), des révélateurs de nos profondeurs abyssales, de nos questionnements identitaires. Dans mon parcours académique, j’ai suivis une formation de physiothérapeute avant ma formation aux beaux-arts, car la connaissance du corps et de sa physiologie m’intriguait totalement. J’ai aussi par la suite étudié le fonctionnement du cerveau et de ses mécanismes de survie, ainsi que toutes les implications hormonales de nos comportements et de nos humeurs. Cette articulation entre ces deux disciplines est au coeur de ma démarche, elle a guidé mes choix et révélé mon identité d’artiste.
Ma pratique, à l’instar de la scène culturelle allemande, est fidèle à cette définition de la peinture selon Gerhardt Richter: «comment introduire une subversion, un processus, une expérience qui ne soit ni un système, ni une planification, liés à l’application d’un savoir, d’une compréhension, mais une action poursuivie, subordonnée au plus singulier, au plus particulier d’un sujet: que le tableau puisse naître du faire» in «Le désir tragique», propos de G. Richter recueillis par Birgit Pelzer.
Je cherche sans cesse ce «faire», aux limites de la spontanéité et de la rigueur, pour créer de nouveaux espaces. Pour moi la peinture échappe au mental. Dans la rigueur absolue d’une direction intérieure, je procède par intuition. Il y a un sens formel et un sens de la couleur qui est en moi et qui doit se structurer à la surface. Comme l’écrivain ou le compositeur, la matière est là, il faut juste lui donner sa forme. Chaque tableau est une étape. Dans l’atelier ils sont alignés par dizaine, et je les travaille tous en même temps. Percevoir les besoins de chacune des surfaces, reliées à l’ensemble. Un puzzle géant, les chapitres d’une même histoire qui s’écrit sur plusieurs années.
La peinture résiste aux mots pour la traduire, il faut la voir dans l’espace et le temps qui lui sont nécessaire. Ces données me sont essentielles. On ne peut pas la «consommer», une disponibilité particulière est utile pour recevoir ce qu’elle a à nous donner. Son essence même est silencieuse, il faut se taire pour qu’émerge sa musicalité. Est-ce le fait d’avoir été emmenée très jeune dans les églises de France et d’Italie, et d’y avoir découvert les fresques monumentales, qui a créé chez moi cette attitude introspective à son sujet ? Devant les Matisse, Van Gogh, Klee, Mitchell, Marden, Dorner et tous les anciens, la peinture offre ce qui est caché, et sacré. Elle révèle à celui qui la regarde le plus intime de luimême, son humanité sombre ou lumineuse. C’est cette disposition qui active ma recherche, afin qu’ensuite la peinture autorise/exprime les doutes, les repentirs, et rende visible les cheminements/acharnements pour parvenir à une certaine cohérence visuelle. Serait-elle un pont entre le réel et nos sens, entre la matière et nous? Une réponse tant substantielle qu’immatérielle aux tensions intérieures et au questionnement existentiel.
Le paysage fictif, rêvé, mémorisé: métaphore de l’inaccessible intériorité?
Dès le début des Beaux-Arts (1989) le paysage s’est imposé comme mon seul motif. Originaire de Belgique, pays où je n’ai jamais habité, entourée de montagnes dans mon lieu de résidence à Genève, mon imaginaire se nourrissait d’un pays inconnu, plat et brumeux, que la peinture et la gravure se plaisait à recréer sans cesse. Une humeur mélancolique s’en dégageait. A cette époque, les dessins de Van Gogh, ces traits bleus nerveux sur le papier, m’ont beaucoup influencée. Les vallées et les forêts, une observation incessante des paysages suisses, sont ensuite apparus pour générer de nouveaux espaces de jeux, de signes, et de lumières. Dès le début, dans la production de grandes toiles, il s’agissait d’échapper à la figuration. Construire un langage personnel et poétique où le regard du spectateur se perdrait dans les différents plans suggérés (pigments mélangés à la colle de peau pour une surface mate), seuls les signes subsistants à la surface (huile et cire mélangées pour les accents brillants). Déjà à cette époque, le spectateur était invité à se déplacer latéralement, créant des changements de lumières et de couleur, dans le but qu’il perde ces repères et plonge mentalement dans la surface peinte.
La photographie a toujours été présente, m’accompagnant comme un carnet de croquis. Un moment, elle fut aussi le support de dessins aux feutres et à la cire (série paysages baroques).
Les deux années parisiennes ont modifiés mon sujet; le champ de la nature a rétrécit pour se focaliser sur les arbres des rues parisiennes (série de peintures acrylique sur bois, début des ponçages pour retrouver le support qui crée la forme) ou la ville crépusculaire (huile sur papier encollé sur bois).
Actuellement (depuis 2005 et les supports en aluminium) ce sont les frondaisons des arbres, les bocages, les limites entre la végétation et le ciel, ces visions parfois banales lors de mes déplacements quotidiens entre ville et campagne, qui m’occupent. J’imagine que cette luxuriance végétale entre directement en communication avec mes cellules nerveuses. Et soudain les arbres et le ciel se confondent pour devenir mes propres cellules. Des cellules globuleuses (globules rouges?) des arborescences tissulaires (muscles ou graisse?), in fine, du vivant organique, biologique. Comme si la peinture permettait un passage entre le végétal et l’humain, une translocation.
Ainsi la peinture répond aux mouvements fondamentaux de mon corps et de mon esprit, légitimant mon existence et la sienne.
Le choix d’un support en aluminium, depuis 2004, est essentiel. Tout d’abord d’un point de vue technique, après avoir pratiqué la toile, le bois, le papier, il offre une base d’une grande résistance physique à ma pratique. Ce «canevas» en métal sur lequel je dépose successivement plusieurs couches de peinture, dans le but de créer une épaisseur de différentes couleurs et teintes, qui sera soit poncée, soit cirée, soit laissée tel quel. Visuellement, il y a la luminosité propre que dégage ce matériau : une froideur métallique, une surface lisse, par plusieurs endroits toujours apparente, qui vient contrecarrer l’aspect lyrique et vivant de la peinture à l’huile. Il est la lumière même, malgré sa froideur. La matière «huile» est tour à tour utilisée de manière classique ; aplats successifs créant les transparences et les profondeurs et de manière inhabituelle. Elle peut être cirée afin de créer des brillances et des reflets ou poncée afin de retrouver d’anciennes couches. Triturée, l’intérêt étant sa grande résistance aux repentirs ainsi qu’à la lumière, qualités intrinsèques immuables.
Les brillances et les matités sont traitées comme la couleur même. La touche, la trace du pinceau apparaît parfois. La touche et la trace des ponçages souvent. Les différentes ponceuses et papiers de verre sont autant de pinceaux agressifs pour un résultat dans la douceur.
Dernièrement, la peinture s’efface totalement pour ne laisser que la gravure suggérer une forme, un motif, en lien avec le paysage fantasmé. Le support, dépourvu de peinture, accroche la lumière par la seule gravure de la surface attaquée par la ponceuse. / Axelle Snakkers
texte de Françoise Mamie
Axelle Snakkers est une artiste vive et précise dont le regard exigeant scrute la matière.
Elle a beaucoup pratiqué la gravure, ce qui explique, peut-être, le lien si particulier qu’elle entretient avec le métal, son support actuel. Son travail est bâti sur les notions de temps et d’espace. Il se développe dans la durée, par touches successives, pour articuler les tensions entre matité et brillance, huile et surface métallique, plein et vide. Le résultat est si lisse qu’on ne peut imaginer le nombre de couches superposées, ni celui des ponçages effectués pour apporter une nuance, retrouver une couleur ou libérer une parcelle d’aluminium.
C’est dans un véritable corps à corps avec la surface fine et résistante que l’artiste réalise des pièces qu’elle reprend sans cesse, parfois durant des années.
Elle aime la confrontation physique avec les matériaux: faire, défaire, poncer, dévoiler le métal, le recouvrir à nouveau. Les repentirs ne se comptent plus ; le cheminement importe autant que le résultat et intègre les mouvements de la vie.
Comme si, avec sa ponceuse, elle creusait en elle-même pour parvenir, par un processus cathartique, à une nouvelle ordonnance, à un apaisement.
Elle peint des arabesques colorées, mais ce ne sont qu’ombres et lumières, jeux de formes immobiles, tellement immobiles qu’elles suggèrent l’infini du cosmos dans une fixité atemporelle. Partant de la découpe des frondaisons sur le ciel, elle construit l’immensité. L’appel du vide est au centre des compositions dont l’apparente sérénité est le fruit d’une sensibilité exacerbée, que l’acte de peindre parvient à transcender à travers la recherche de l’équilibre formel. Les travaux les plus récents s’émancipent de ce va et vient des effacements et des recouvrements. Ils affirment d’une façon limpide le rapport entre le peint et le non peint ; les aplats délicats réduisent la distinction entre les matières et intensifient le sentiment d’espace. Certains disques métalliques sont même totalement dénués de couleur pour ne laisser apparaître que des éclats de lumière d’une éblouissante simplicité.
Si Axelle Snakkers cite Beuys dont le travail exprime tant la sensation du vivant, elle se sent proche de la peinture américaine, celle de Brice Marden, en particulier. Le geste crée la pensée : « Commencer une pièce, c’est comme se jeter dans le vide », dit-elle « se mettre dans un état de réceptivité qui laisse place au lyrisme, à la plasticité, à l’émergence des possibles ». / Françoise Mamie
Imperfect Landscapes
Axelle Snakkers is a vibrant and precise artist. Her demanding eye is forever scrutinising the matter of reality on which it focuses.
She is a highly skilled printmaker, which perhaps explains her close relationship with her current medium, metal. Her work hinges on notions of time and space gradually emerging from successive touches; slowly bringing to life tensions between matte and glossy, oil and metal, fullness and emptiness. The result is so smooth that it is difficult to imagine the number of superimposed layers and recurring polish needed to bring forth the nuances, the search of a colour or the release of a slither of aluminium.
It is literally during this close combat against the fine resistant surfaces that the artist produces pieces which she then continues to work on incessantly, sometimes for several years. She delights in the physical confrontation with the material: to do and undo, polishing over and over, revealing the underlying metal, only to cover it up again. The long road of trial and error is as important as the final result integrating the motions of life themselves. As if, she was painstakingly engraving her own self with a grinder to achieve a new level of appeasement through a cathartic process.
She paints colourful arabesques made of simple light and shade, a display of motionless forms, so still that they suggest cosmic infinity and timeless immutability. From the outlines of airy foliage she builds immensity. The apparent serenity imminent from the attraction of the void at the centre of the compositions is the fruit of an exacerbated sensitivity transcended by the act of painting and the search of a formal balance.
Her more recent works show emancipation as a result of this to-ing and fro-ing, rubbing and adding. The relationship between the painted and unpainted is thus clearly established, the delicate applications minimise the distinction between the layers and intensify the feeling of space.
Though Axelle Snakkers quotes Beuys whose work so loudly expresses the feeling of life, she also feels close to American painting, in particular the work of Brice Marden. Movement fashions thought: “To start a new work is like jumping into thin air” she says “to place yourself in a state of complete receptivity allowing lyricism, plasticity, and an infinite array of possibilities to emerge”. / Françoise Mamie
texte de Philippe Constantin
Texte de Philippe Constantin écrit pour l’exposition «Faits divers» à la S.I.P (1994)
«On peut bien dans le noir
Allumer la bougie
Et s’asseoir auprès d’elle Sur la table posée
Pour le très grand plaisir
De regarder la flamme» Guilevic
L’écriture détaille parfois le signe, offrant au trait des mots qui se déposent dans nos pas.
Leur empreinte en multiplie le sens. On ne peut ainsi se perdre en nul paysage sans entendre une musique nous accompagner, car le mouvement est en lui. Il nous conduit à nous rencontrer, recomposant le rythme de la mémoire, fragmentant la lumière, comme pour courber sous elle la matière noble des transhumances.
On ne sais d’où la mémoire nous est alors faite en don, mais on la pressent comme cet espace privilégié du repos où nait la calligraphie de nos chemins à venir. C’est un lieu de résonnance, à l’écoute de son corps, destiné à nous y inscrire plus volatiles et plus fermement aussi, au fur à mesure que nous la remodelons ou la façonnons à l’image de ce corps transparent. Je l’ai reconnue vivante, organique, participant pleinement à la nature, ou nature elle-même, qui s’organisait, ajoutant à la toile de son paysage l’épiderme par lequel elle se lie et respire.
Ici le temps aussi est venu jouer de sa subjectivité pour amplifier l’espace. Ombre et mémoire. Temps et vent. Il nous laisse libres de cette étendue, ne répondant au chaos ni à la genèse, mais voué plutôt à l’exégèse de sa propre partition, où frémissent à ses lèvres les signes qui nous dévoilent. On y découvre, non pas notre ignorance, mais ce qu’on ignorait de nous-mêmes. On n’y invente pas, car le support, par le jeu de son écriture polymorphe, nous suspend à nos constructions et disparaît sur ses chemins. Mais on y retrouve, par contre, notre connaissance insigne et modeste de la vue.
L’œil éclot en nous à chaque pas nouveau, comme ces paysages déhiscents allient en eux la mémoire et la sensibilité jusqu’à notre maturité, renaissante sans cesse, parce qu’elle ne peut jamais que s’enrichir de cet espace intérieur et son œil redécouvert. / P. Constantin-K.
texte d’Eric Suchère
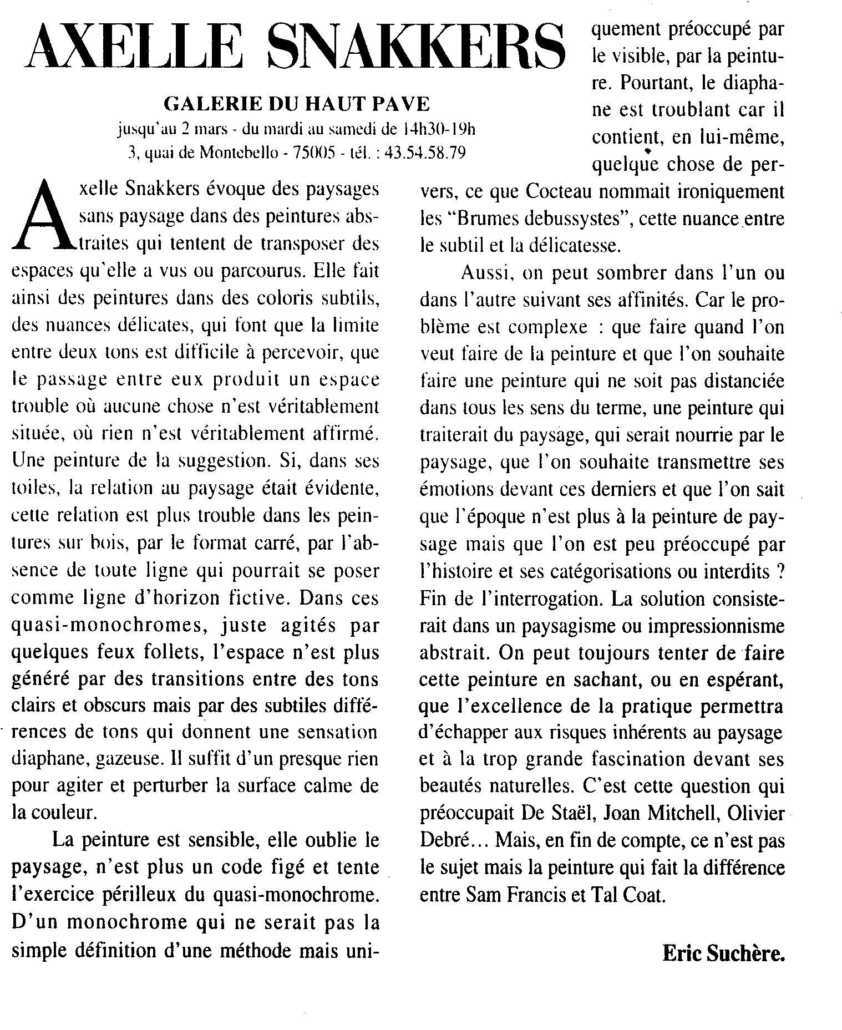
livre "Jupiter"
Aucun des livres «les planètes» n’est sur le travail de l’artiste. Il s’agit d’un texte fait à partir de ce travail. Ni le texte, ni les œuvres ne s’illustrent. Les deux, se complètent et peuvent se parasiter. Les livres ne paraîtront pas dans l’ordre de succession des planètes au sein du système solaire mais dans le désordre. Il s’agit de créer un puzzle et non une lecture linéaire.
Livre sortit à l’occasion de l’exposition des gravures d’Axelle Snakkers à la galerie Area en janvier 1996 (Paris)
Texte d’Anne Toia, LÀ OÙ LA COULEUR SE SOUVIENT, 2025
LÀ OÙ LA COULEUR SE SOUVIENT
La peinture d’Axelle est un territoire à part. Un champ mouvant de stries, de couches, de lames, où chaque geste laisse une cicatrice sensible, une trace vivante.
Ses toiles naissent dans l’instinct, portées par un élan brut, organique, où la matière parle avant la forme. Rien n’y est immédiat : chaque surface se construit lentement, couche après couche, dans un va-et-vient de dépôts et d’effacements, de recouvrements et de dévoilements.
Axelle gratte, superpose, efface. Sa peinture est un palimpseste - un espace où le temps s’accumule, où chaque stratification garde la mémoire des gestes passés. Ce qui semble lisse est habité ; ce qui surgit en surface vient de loin.
Des signes affleurent – cryptés, primitifs, presque cosmiques – échos d’un langage venu d’un autre plan, d’un monde intérieur autant que céleste. Dans ces paysages abstraits, tout est suggestion : un souffle, une lumière, une vibration presque inaudible.
Ici, le rouge s’embrase et devient souffle brûlant, le champ solaire se fissure de lueurs suspendues, comme deux paupières d’or dans un ciel en fusion. Là, une étendue verte, minérale, déroule ses strates, comme une terre ancienne marquée de veines blanches, empreintes de vent ou d’eau fossile. Ailleurs, une bande végétale, verticale et dense, palpite entre deux masses métalliques, équilibre parfait entre contrôle et pulsation, entre nature contenue et souffle libre.
Axelle explore l’entre-deux : entre le chaud et le froid, entre le silence et la résonance, entre la mémoire du sol et le pressentiment du ciel.
Elle peint avec le corps et l’intuition, laissant la couleur parler avant le motif, la trace avant le mot. Chez elle, rien n’est figé, tout respire.
Une peinture de tension, de silence, de vibration. Une peinture qui ne se donne pas d’un coup d’œil, mais qui se dévoile – lentement, profondément.
Anne Toia 01.07.25
Texte de Marie-Claude Martin, Labeur donne des ailes, 2025
«Le beau n’est pas l’effet du hasard, il est le fruit d’une inspiration persévérante qui n’est qu’une suite de labeurs opiniâtres», Eugène Delacroix.
Labeur donne des ailes
Axelle Snakkers balaie nos idées reçues, nous arrache aux évidences, nous lave le regard et donc nous rafraîchit la pensée; elle lui injecte un nouveau souffle. Dans un monde où la consommation est l’alpha et l’oméga de nos existences, elle redonne noblesse et beauté à une notion dépréciée : le labeur.
Avec elle, il n’est pas qu’un travail répétitif et scolaire, il est source de joie. Et peut-être même source de joie parce que répétitif. Axelle est une labo-rieuse: elle expérimente en laboratoire; elle teste; elle cherche, dans la gaité, le sourire au bout de sa ponceuse.
Il faut aussi entendre labeur dans son sens typographique : en imprimerie, le labeur désigne un travail de composition et de tirage important, qui nécessite patience, savoir-faire, ambition et modestie.
Comme un travail paysan….
Le mot fait penser à un autre univers, celui de la terre. Comme les paysans qui doivent respecter les besoins et les tourments de la nature pour la rendre fertile, Axelle Snakkers est à l’écoute de ses grandes feuilles de métal qu’elle travaille dans un corps-à-corps très physique. Si elle a troqué pinceaux, pastels et crayons contre une série de ponceuses, c’est parce que l’outil permet d’entrer dans la matière comme le soc de la charrue sculpte et féconde la terre.
…ou une activité monastique
J’en reviens à ce mot, labeur, qui est également une réalité monastique : laisser le temps faire son œuvre. Axelle peut travailler dix ans sur un tableau, dialoguer avec lui, s’étonner de ce qu’il devient, prendre de ses nouvelles, le mettre de côté, l’oublier, le faire revenir, le corriger, le rectifier, le compléter, en faire trop, se repentir, repasser une couche, enlever de la matière, en remettre, griffer, gratter, et parfois vernir. Elle est en conversation permanente avec ses œuvres à qui elle témoigne reconnaissance et gratitude dans un rapport tour à tour amical et confrontant. Elle trouve en cherchant, sans savoir ce qu’elle cherche, tout en le sachant profondément. C’est ainsi d’ailleurs que les enfants découvrent le monde, et c’est ainsi qu’Axelle Snakkers le restitue dans son langage pictural finement ciselé.
De l’unicellulaire à la galaxie
Ses tableaux sont des mondes, des univers, du plus petit au plus grand. Est-on dans le micro ou dans le macro? Ces ronds au centre de toutes ses tableaux sont-ils des galaxies ou des unicellulaires passés à la loupe? Des parties ou un grand tout? Des miroirs qui nous renvoient ce que nous sommes ? Des trous noirs qui nous absorbent ? Des boucliers qui nous mettent à distance ? Des soleils noirs qui révèlent les mélancolies d’un monde en voie de disparition ou des lunes pleines qui nous font rêver d’un ailleurs meilleur?
Marie-Claude Martin
Aout 2025
«Je ne cherche qu’à réveiller les terminaisons nerveuses de mes spectateurs»
Francis Bacon
